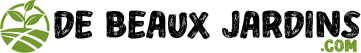La permaculture, cette approche holistique du jardinage et de l’agriculture inspirée des écosystèmes naturels, trouve dans les serres un allié précieux pour étendre ses possibilités. Loin d’être un simple abri pour plantes, la serre en permaculture devient un véritable écosystème où chaque élément interagit harmonieusement avec les autres. Cultiver sous serre tout en respectant les principes de permaculture permet de créer un espace productif et résilient. Voyons comment ces espaces couverts peuvent amplifier les principes permacoles tout en offrant des avantages considérables aux jardiniers soucieux de durabilité.
Pourquoi associer serre et permaculture ?
L’union de la serre et de la permaculture répond à plusieurs défis. D’abord, elle permet d’étendre la saison de culture dans les climats locaux tempérés ou froids, offrant la possibilité de cultiver toute l’année des espèces habituellement limitées aux mois chauds. Ensuite, elle crée un espace contrôlé où observer l’environnement, la synergie entre espèces et l’efficacité énergétique peuvent être optimisés.
La serre permacole se distingue fondamentalement des serres conventionnelles par sa conception intégrée. Plutôt que de créer un environnement artificiel entièrement dépendant d’intrants extérieurs, elle vise à établir un système largement autorégulé qui maximise l’utilisation des ressources naturelles disponibles pour optimiser le rendement tout en respectant la nature.
Conception d’une serre permacole
Orientation et structure
L’orientation est cruciale : idéalement, une serre permacole doit être orientée est-ouest avec sa face la plus longue au sud (dans l’hémisphère nord) pour capter un maximum de diffusion lumineuse en hiver. La structure peut varier, des modèles classiques en verre aux tunnels en plastique, en passant par des constructions plus originales comme les serres enterrées ou semi-enterrées (walipinis) qui utilisent l’inertie thermique du sol.
Les matériaux choisis reflètent souvent la philosophie permacole : récupération, durabilité et efficacité énergétique. Le bois local non traité, les bouteilles recyclées, ou même les balles de paille peuvent servir à la construction.

Gestion thermique passive
Le stockage de chaleur est au cœur de la serre permacole. Des masses thermiques comme des fûts d’eau, des murs en pierre ou des lits de culture surélevés emmagasinent la chaleur du jour pour la restituer la nuit. Cette approche réduit considérablement le besoin en chauffage artificiel.
Des systèmes ingénieux comme les puits canadiens (ou provençaux) permettent de préchauffer l’air entrant en hiver et de le rafraîchir en été en le faisant circuler dans des tuyaux enterrés où la température du sol reste constante, améliorant ainsi la circulation de l’air.
Organisation de l’espace intérieur
Organiser l’espace intérieur d’une serre permacole répond aux principes de zonage et d’utilisation de l’espace vertical caractéristiques de la permaculture :
- Les variétés adaptées les plus exigeantes en chaleur et lumière sont placées au centre ou au sud
- Les espèces plus tolérantes à l’ombre se situent au nord
- Les plantes grimpantes occupent l’espace vertical
- Les bassins ou aquaponie peuvent être intégrés pour la culture de plantes aquatiques et l’élevage de poissons
L’aménagement intérieur favorise la biodiversité végétale, avec différentes hauteurs de culture permettant de multi-étager les cultures et la cohabitation d’espèces complémentaires formant des guildes végétales pour maximiser la densité productive.
Gestion de l’eau et fertilité
Systèmes d’irrigation économes
La récupération des eaux de pluie depuis le toit de la serre alimente des systèmes d’irrigation goutte à goutte, d’oyas (pots en terre cuite poreux) ou de wicking beds (lits à mèche). Ces méthodes permettent d’économiser l’eau tout en maintenant une humidité optimale.
Cycles de fertilité fermés
Le compost maison, la lombriculture et le thé de compost sont intégrés directement dans la serre, créant un cycle fermé de nutriments. Certains permaculteurs y ajoutent même un petit poulailler pour bénéficier du fumier et de la chaleur dégagée par les volailles.
Les engrais verts comme les légumineuses enrichissent le sol naturellement en fixant l’azote, tandis que d’autres espèces aux racines profondes remontent les minéraux des couches inférieures, améliorant ainsi la qualité du sol.

Biodiversité et équilibre naturel
Contrôle biologique des ravageurs
La diversification des cultures et l’intégration de plantes compagnes et répulsives limitent naturellement les problèmes phytosanitaires. Des plantes comme la tanaisie, la lavande ou le basilic repoussent certains insectes nuisibles.
L’introduction volontaire d’auxiliaires (coccinelles, chrysopes, syrphes) participe à l’équilibre de l’écosystème. Des hôtels à insectes et des points d’eau encouragent leur installation permanente.
Pollinisation et micro-faune
Contrairement aux serres conventionnelles hermétiques, les serres permacoles prévoient des ouvertures permettant l’entrée contrôlée de pollinisateurs. Certains permaculteurs installent même des ruches à proximité immédiate.
Le sol vivant, riche en matière organique et en micro-organismes, constitue la base d’un écosystème sain. Les techniques de non-travail du sol et de paillage du sol favorisent cette vie souterraine essentielle.

Défis et solutions
Gérer les excès de chaleur
Si le chauffage est souvent une préoccupation sous nos climats, la surchauffe estivale peut devenir problématique. Des systèmes d’ombrages automatiques ou saisonniers (canisses, plantes grimpantes caduques), combinés à une ventilation efficace, permettent de réguler la température.
Maintenir l’équilibre hydrique
La gestion de l’humidité peut être délicate dans un espace clos. Une bonne ventilation et la présence de plantes adaptées à différents niveaux d’humidité créent un gradient bénéfique.
Éviter la fatigue des sols
Le sol confiné d’une serre peut s’épuiser plus rapidement. La rotation des cultures, les engrais verts et l’apport régulier de matière organique diversifiée préviennent ce phénomène et permettent des récoltes échelonnées tout au long de l’année.
Exemples inspirants
De nombreux projets démontrent le potentiel des serres permacoles :
- Les serres bioclimatiques de Sepp Holzer en Autriche, qui produisent même en hiver rigoureux
- La serre du Bec-Hellouin en Normandie, où l’aquaponie complète les cultures en pleine terre
- Les serres enterrées des Andes, qui permettent de cultiver dans des zones extrêmement froides
La serre permacole : un microcosme vivant en perpétuelle évolution
Plus qu’une simple structure agricole, la serre en permaculture représente un microcosme où s’appliquent concrètement les principes fondamentaux de cette approche : observation de la nature, optimisation des ressources, économie d’énergie et création de synergies.
En intégrant consciencieusement les cycles naturels plutôt qu’en luttant contre eux, la serre permacole offre une solution résiliente face aux défis climatiques actuels. Elle permet non seulement d’étendre la période productive, mais aussi d’approfondir notre compréhension des interactions écologiques tout en fournissant une abondance alimentaire diversifiée.
Pour qui souhaite se lancer dans l’aventure, le conseil principal reste fidèle à l’esprit permacole : commencer petit, observer attentivement, et laisser le système évoluer progressivement vers son équilibre optimal.